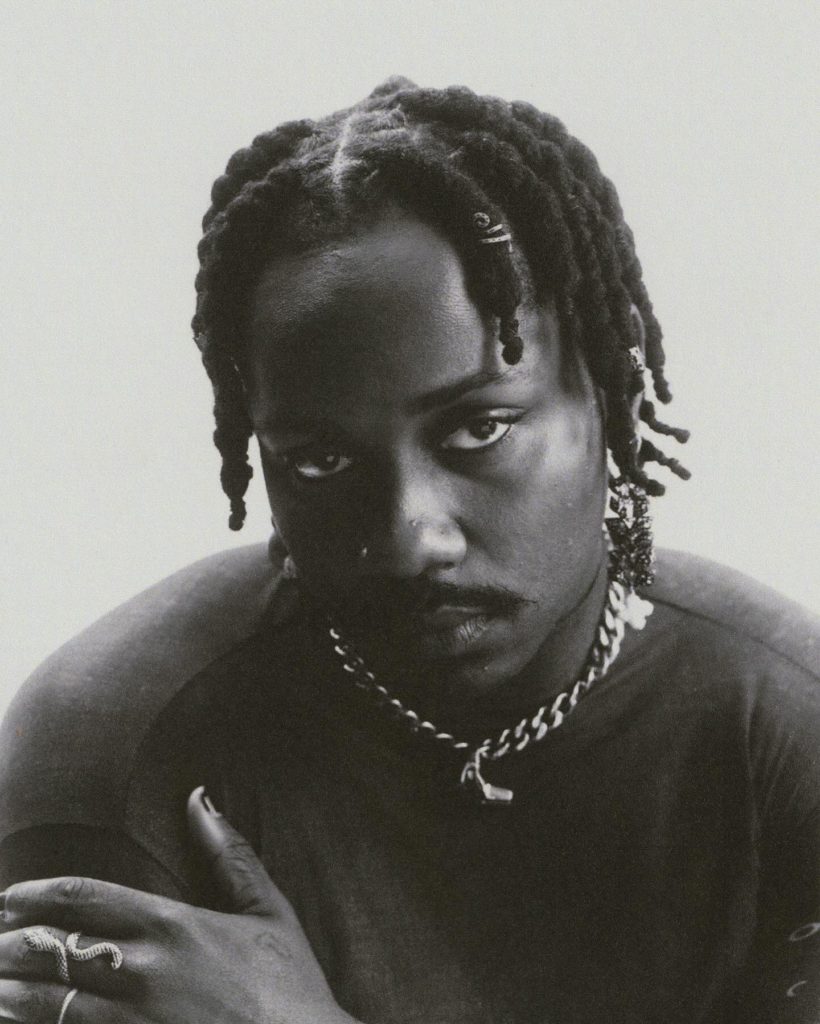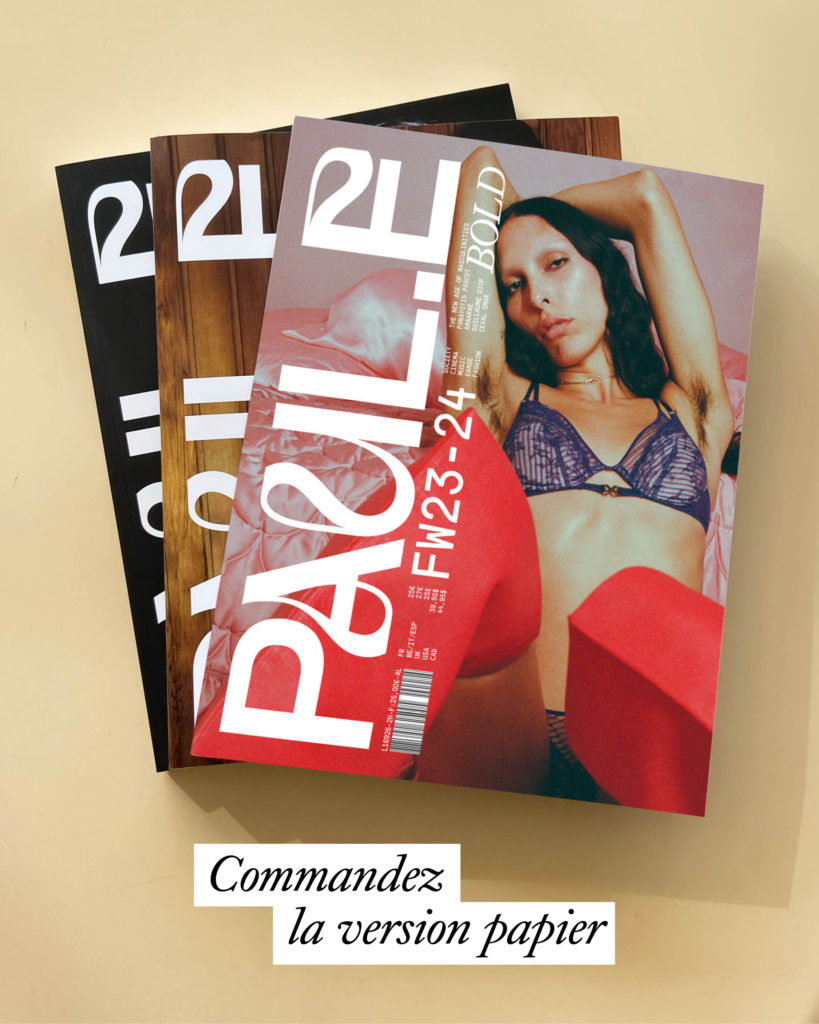LE MYTHE DE LA SIRÈNE : D’ARIEL A NOS JOURS
Le personnage fictif de la sirène connait un grand succès dernièrement. Avoir une queue de sirène pour aller à la piscine, ou une bouée écaillée par exemple, deviennent des moyens d’être à la mode. Aujourd’hui, elle est considérée comme un idéal de féminité pour sa sensualité, sa beauté et sa force. Mais les choses n’ont pas toujours été ainsi. La figure de la sirène a connu de nombreux changements à travers le temps, de son origine en tant que créature aérienne à sa forme marine actuelle. Cette créature, qui revient constamment à travers l’histoire, refléterait-elle nos préoccupations concernant la place de la femme dans la société ?
Les sirènes sont d’abord apparues dans le poème épique de Homère, L’Odyssée. Elles étaient mi-femme, mi-oiseau, et perçues comme une menace pour les hommes, plus particulièrement pour les marins, à cause de leur pouvoir. En effet, la voix des sirènes était la hantise des hommes en mer ; quiconque l’entendait était sûr de mourir, car il se jetait par-dessus bord pour essayer d’atteindre les sirènes en vain. Les marins se noyaient tandis qu’elles continuaient de chanter sans merci. Leur voix était donc la source de leur pouvoir, et non pas leur beauté physique.

Crédit: Disney 
Crédit: @mirdinara
Cependant, quand on parle de sirène, la première qui nous vient à l’esprit est celle de Christian Hans Andersen, adaptée au cinéma par Disney : la petite sirène, Ariel. Or, dans ces deux histoires on peut remarquer que la sirène est devenue une créature de l’eau attirante, qui choisit de renoncer à sa voix. Dans ces contes, elle vit sous la mer et tombe amoureuse d’un prince humain. Prête à tout pour le rejoindre sur terre, la sirène choisit de sacrifier sa voix pour une paire de jambes. Elle peut maintenant marcher dans le monde des mortels, mais est incapable de parler.
Il ne faut pas sous-estimer la charge symbolique de cet échange. La sirène, en sacrifiant sa voix, renonce à ce qui était auparavant la source de son pouvoir, qui lui permettait de dominer les hommes. La sirène passe de prédatrice dangereuse pour les hommes, à bel objet de contemplation inoffensif. Elle se plie à l’injonction « Sois belle et tais-toi ». Plutôt que d’attirer les hommes sous l’eau, c’est elle qui se retrouve attirée hors de son environnement naturel. Dans la littérature et au cinéma, la sirène n’est plus une prédatrice, mais devient une proie.

Crédit: @sibylline_m 
Crédit: @sibylline_m
Cette évolution est très problématique, car elle semble dire aux lecteurs et spectateurs que les jeunes filles ne peuvent trouver l’amour, et être aimées, seulement si elles sont belles, et silencieuses – obéissantes. Ces contes de fées ne montrent pas des femmes fortes et indépendantes, mais des personnages dont la personnalité est considérée comme étant moins importante que l’apparence, et dont le seul but est d’être en couple. Cela dit, le film récent La forme de l’eau de Guillermo del Toro est une interprétation plus moderne du mythe de la sirène. Elisa peut être perçue comme une sirène, vu qu’elle est retrouvée enfant à côte de l’eau, muette. Comme dans la version de Andersen et Disney, elle a échangé ses cordes vocales pour une forme humaine. A la fin, les cicatrices sur son cou s’avèrent être des branchies. Tout au long du film, Elisa se rebelle contre l’ordre établi, et ne se laisse jamais dicter ses gestes par le patriarcat.
De nombreuses séries télévisées ont aussi fait l’éloge de la sirène, en la représentant comme un personnage mythologique féminin inspirant et positif. La sirène reste sans aucun doute un personnage fascinant, qui nous pousse à nous interroger sur notre conception de la féminité, le genre et la sexualité.
Article de Inès Huet